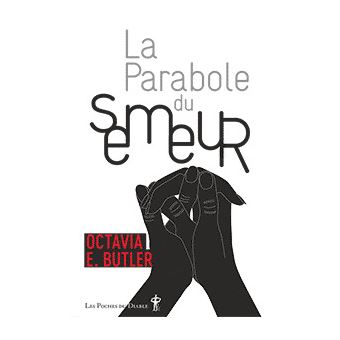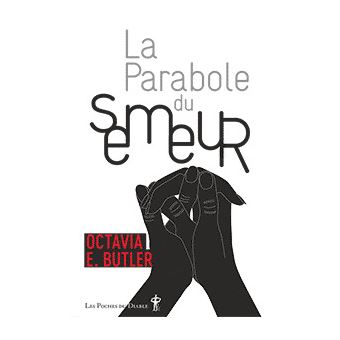Petit Rappel
Robert Heinlein, immense auteur de SF, proposa durant l’âge d’or de la science-fiction de remplacer le terme « science » par « speculative », obtenant une nouvelle catégorie – Speculative Fiction, tout en gardant le même acronyme, SF. Le but était de regrouper les romans dont les éléments s’éloignaient des poncifs purs et durs de la SF traditionnelle. En effet, de nombreux écrits offraient à lire des histoires se déroulant dans un cadre très réaliste tout en explorant les évolutions possibles de l’humanité. Les aspects sociétaux, climatiques, environnementaux, politiques et j’en passe était abordés de manière à brosser un futur plausible de la civilisation. Si on ne veut aborder que la branche parlant de pollution / dérèglement climatique / effondrement des structures sociétales, on peut évoquer trois livres majeurs : « Soleil vert » (titre français inepte, Make room ! Make room ! en anglais, ’66) d’Harry Harrison, « La fin du rêve » (’72) de Philip Wylie et « Le troupeau aveugle » (’72) de John Brunner. Les trois sont glaçants de réalisme. Et toujours d’actualité ! En francophonie, on associa parfois ce type de romans au terme « prospective ».
Une vision pourtant très actuelle
Le roman d’Octavia E. Butler s’apparente lui au sous-genre post-apocalyptique. Sensé se dérouler en 2024, il décrit une société américaine en totale déliquescence : dollar effondré, émeutes, misère généralisée, épidémies, la rue livrée à l’ultra-violence, le tout découlant d’une présidence catastrophique et d’un régime totalement acquis à l’ultra-libéralisme. Un exemple, ces multinationales qui rachètent des villes entières pour mettre au travail les populations contre de bien précaires versions des notions de gîte, de couvert et de sécurité. En fait, une forme à peine masquée d’un nouvel esclavagisme. Vous réagirez peut-être en faisant la liaison avec des manifestes tels que le livre « Et c’est ainsi que nous vivrons » de Douglas Kennedy (2023) ou le film Civil War (Alex Garland, 2024), pamphlets à peine masqués sur la présidence U.S. actuelle. Et bien non ! « La Parabole du semeur » a été publié en ’93 aux Etats-Unis. Prophétique, donc. Butler a été une des rares autrices Afro-Américaines active dans le domaine de la science-fiction. Traduite de manière confidentielle en français (dès ’76) alors qu’elle jouissait d’un franc succès chez elle, elle est le pendant féminin de Samuel Delany (« Babel 17 », « Nova »), autre géant du genre. Petite-fille d’esclaves, elle n’a jamais manqué de faire écho à la condition des Afro-Américains dans un pays contrasté et contradictoire (« Kindred », 1977). Lauréate à deux reprises du prix Hugo (’84 et ’85, catégorie Nouvelles) et du non moins prestigieux prix Nebula en ’94 pour la suite du présent ouvrage, « La parabole des talents ». On peut ajouter qu’elle a été le premier écrivain de science-fiction à décrocher le prix Genius de la fondation Mac Arthur (’95). Elle était également une précurseure de l’afrofuturisme (tout comme Delany). Octavia E. Butler est décédée prématurément et brutalement en 2006, à l’âge de 59 ans.
Fureur et chaos
Le roman est raconté à la première personne par Lauren, 15 ans, fille d’un pasteur Afro-Américain et d’une junkie. Elle est douée d’hyper-empathie, ressentant physiquement la douleur et le plaisir d’autrui. Témoin de la fureur et du chaos généralisés en Californie, elle se forge une doctrine qu’elle note scrupuleusement dans son journal. Mélange de religion, d’humanisme et de visions du futur, elle la nomme Semence de la terre : le livre des vivants. Après l’éradication de sa communauté par un groupuscule de drogués nihilistes et meurtriers sous le regard bienveillant d’une police corrompue et démobilisée, elle rejoint une colonne de réfugiés cherchant une terre plus accueillante, quelque part, au Nord. Cet exode, cauchemardesque tant il sera sous la menace permanente de prédateurs sans foi ni loi, sera l’occasion de rencontres inespérées, sources de comportement humains aussi dignes que réconfortants. Le tout consigné dans le journal de l’héroïne.
La parabole du semeur est un superbe roman. Brutal, il ne fait aucune concession quand il s’agit de brosser le décor d’une société en proie à la barbarie. Les conditions de vie des civils, misérables, et le chaos généralisé sont évoqués avec beaucoup de justesse, sans fard. À l’opposé, quand l’auteure nous plonge dans cette vision d’une vie meilleure qu’a Lauren, c’est l’apaisement qui prévaut. Plébiscite aussi pour une galerie de protagonistes finement campés, avec leur lot de contradictions et d’interrogations, leur volonté de survivre plutôt que d’abandonner la partie malgré un environnement délétère et létal. Enfin, il faut souligner la cohérence de la description des ravages causés par un régime ultra-libéral carnassier dont l’inanité est sans bornes. Ce livre peut être lu par beaucoup de catégories de lectrices et lecteurs, il n’est pas exclusif. En ces temps troublés et chaotiques, il pose les bonnes questions et génère nombre d’interrogations. Personnellement, je vais poursuivre le voyage avec la suite, « La parabole des talents », toujours dans cette élégante collection de poche.