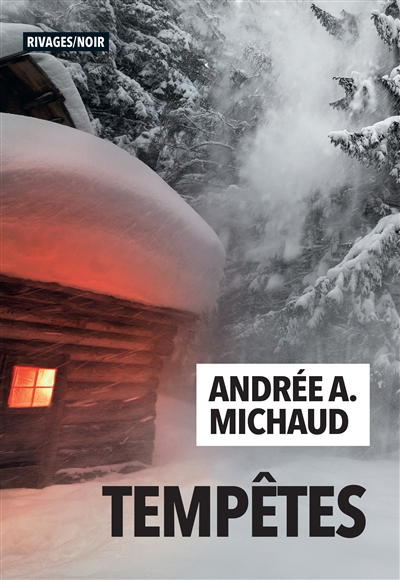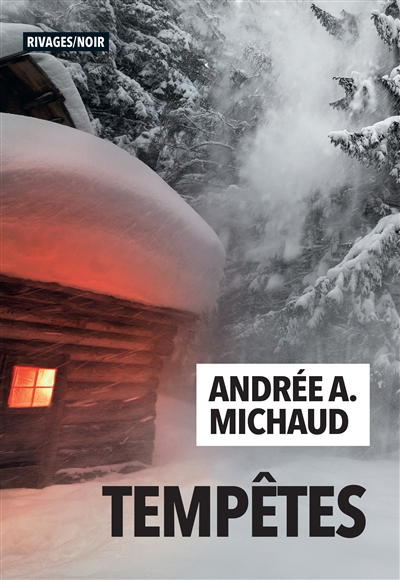Il est de ces auteurs que l’on se réjouit de lire. Parce qu’on en a entendu tellement de bien, que les mots utilisés pour parler d’eux dans la presse et/ou sur certains blogs semblaient indiquer qu’à nous aussi, forcément, leur dernier titre, fraichement publié, allait plaire. Puis, un jour, il est là sur la table, à portée de main et, d’impatience, on laisse tomber la lecture qui nous occupait. Parfois, on ne devrait pas.
Recluse et délirante
Une maison isolée sur le flanc de Cold Mountain, une femme dont on ne sait rien, seulement qu’elle vient d’hériter de cette bicoque de son oncle suicidé quelques temps auparavant. Ah si, elle s’appelle Marie Saintonge, un patronyme qui fleure bon le Québec d’origine de l’auteure, Andrée A. Michaud, dont il s’agit ici du troisième roman publié par Rivages. Dieu sait si on aime les éditions Rivages. James Harvey, Dennis Lehane, Bill James ou James Ellroy figurent à leur catalogue et rien que pour ça, on continuera à les aimer. Mais revenons à Marie. Pendant les 90 premières pages, il nous est difficile de faire la part entre ce qu’elle vit réellement, ce qu’elle croit vivre et ce qu’elle rêve ou plutôt cauchemarde. À peine installée dans la maison de feu son oncle, la voici isolée du reste du monde par une tempête dont la région semble posséder le secret. Et les silhouettes étranges de se former autour d’elle, mirages formés par la neige et le vent, les plastiques occultant les fenêtres de se gondoler bizarrement ou les bruits non-identifiés de se faire entendre à qui mieux mieux. Pendant ce temps-là, Marie écluse le rouge qu’elle a pris soin de planquer dans la cahute et le lecteur s’emmerde sévère, il n’a même pas peur, alors que Marie, elle, semble trouiller sa race. Il a l’impression qu’on le balade, voilà 90 pages qu’il n’a rien appris ni compris, et elle est où cette noirceur ou cette plongée dans les affres d’une âme tourmentée dont parlaient avec force trémolos ses confrères ? Lui, il n’y voit que le délire incohérent (si, un délire peut être cohérent, voyez « Shutter Island » de Lehane) et foutage de gueule majestueusement mal écrit. Parce que la beauté du style tant vantée par ailleurs, elle aussi, il s’en sent floué. Les phrases ne sont pas sèches, elles sont plates ; et le vocabulaire n’est ni évocateur ni riche, il participe même aux causes du désintérêt général que provoque l’ensemble. Il ne suffit pas de savoir écrire de longues phrases pour être un bon auteur. Quand on répète quatre fois l’expression « le verre échappa mes mains » sur 90 pages, ce n’est plus de la figure de style québécoise, c’est du laisser-aller.
La règle des (presque) 100 pages
Et donc, à la 91e page, le bouquin échappa nos mains. Peut-être que la suite nous aurait plu. Et nous aurait permis d’être moins sévère ici. Mais 90 pages, ça ne fait pas loin d’un tiers des 332 de l’ensemble. Il nous paraît que si un lecteur doit garder l’esprit ouvert pour entrer dans l’univers et le style personnel d’un auteur, ce dernier devrait également avoir un minimum de respect pour lui en ne tricotant pas le premier tiers de son bouquin avec d’incompréhensibles et finalement assez énervants délires alcoolisés et neigeux. Trop de bons livres et pas assez de temps. On passe à autre chose.